Anosognosie : savoir, ne pas savoir… ou remplacer le réel ?
Résumé
L’anosognosie désigne l’absence de conscience d’un déficit (moteur, sensoriel, cognitif) — classiquement après lésion cérébrale. Mais au lit du patient, un phénomène plus frappant apparaît : non seulement le sujet ne reconnaît pas le trouble, il peut le remplacer par une réalité virtuelle (confabulation d’une action réussie, justification élaborée, perception « normale » malgré une cécité corticale). Cette page propose : (1) un repérage clinique et neuroscientifique actuel ; (2) une mise en perspective : que juge-t-on « réel » ? (témoignage du patient vs preuve opératoire), et comment soigner sans écraser la parole du vécu.
I. L’anosognosie : repères cliniques et neuroscientifiques
1) Origine et définition
Le terme est proposé en 1914 par Joseph Babinski à propos de patients hémiplégiques qui, interrogés, nient ou ignorent leur paralysie. Une patiente, invitée à lever les deux bras, élève le droit mais pas le gauche et affirme l’avoir fait : c’est l’écart entre le fait et l’affirmation qui intrigue Babinski. On parle depuis d’« anosognosie pour hémiplégie » (AHP) et, plus largement, d’anosognosies sensorielles ou cognitives (ex. cécité corticale avec conviction de voir, dite syndrome d’Anton-Babinski). Voir la traduction commentée du texte original (Babinski 1914).
Langer & Levine, Cortex, 2014.
2) Qu’observe-t-on au lit du patient ?
- Non-conscience du trouble : le patient se dit « normal ».
- Explications substitutives (confabulations) : « Je l’ai bougé », « Je n’ai pas essayé », « C’est votre faute ». Des études expérimentales montrent que des patients AHP rapportent avoir effectivement exécuté des mouvements impossibles (ex. main paralysée).
Fotopoulou et al., Brain, 2008 ;
Jenkinson & Fotopoulou, JNNP, 2010. - Latéralisation : souvent après lésion de l’hémisphère droit (régions pariéto-insulaires/temporales).
Vocat & Vuilleumier, Brain, 2010. - Variabilité : conscience partielle, fluctuation au cours du temps, modules touchés (moteur, visuel, mémoire…).
Prigatano (OUP, 2010).
3) Mécanismes proposés (très bref)
Plutôt qu’un simple « refus », les modèles récents décrivent un dysfonctionnement de mise à jour : échec à intégrer les signaux d’erreur issus du corps dans un modèle de soi (cadres de type prédiction/prédiction d’erreur, intégration interoceptive, atteinte des réseaux pariéto-insulaires).
Encadré — Anosognosie ≠ Déni ≠ Contrôle
- Anosognosie : trouble neurocognitif de la conscience du déficit (mécanismes cérébraux), souvent avec confabulations crédibles pour le sujet.
- Déni : mécanisme psychique (défense) face à l’angoisse d’un fait reconnu ailleurs (registre psychodynamique).
- Contrôle : stratégie volontaire (contrôler l’image de soi, minimiser en public), sans altération primaire de la conscience du trouble.
4) Exemples sensoriels : voir sans voir, sentir sans sentir
Anton-Babinski : cécité corticale avec conviction de voir et descriptions confabulées (revue historique).
Carvajal et al., 2012.
Olfaction : durant la COVID-19, plusieurs équipes ont montré un écart important entre auto-déclarations et tests psychophysiques (UPSIT/Sniffin’ Sticks) : jusqu’à ~95–98 % de dysfonction objectivée quand une fraction moindre s’en dit consciente — signe d’inconscience partielle du déficit.
Moein et al., 2020 ;
Bourlon et al., 2021.
II. Au-delà du « ne pas savoir » : quand le cerveau remplace le réel
Dans bien des cas, l’anosognosie n’est pas un simple « trou » de connaissance. C’est un trou comblé. Le sujet ne dit pas « je ne sais pas » ; il produit une version plausible de lui-même agissant normalement. En AHP, des patients affirment avoir bougé un membre paralysé ; en cécité corticale, ils « voient » précisément ; en hyposmie, ils « reconnaissent » des odeurs sur indice mais échouent aux flacons neutres. Ces substitutions (confabulations, illusions d’action ou de perception) correspondent à un modèle de soi qui ne se met pas à jour faute d’erreurs prises en compte.
Mini-modèle intuitif (prédictif)
Le cerveau prédit en continu « ce que je suis en train de faire/ressentir ». Si les signaux d’erreur (qui diraient « tu ne bouges pas », « tu ne vois pas ») n’atteignent pas les systèmes de mise à jour (lésion, déconnexion), la prédiction gagne : je me ressens agir/voir. Le réel manquant est remplacé par une image cohérente avec mon identité d’avant-lésion.
III. Qui décide du « réel » ? (phénomènes, preuves, soin)
En clinique, on confronte deux registres : le témoignage phénoménal (« je le fais/je le sens »), et la réalité opératoire (tests, observation, imagerie). Dire « vous vous trompez » n’a de sens qu’à condition d’accompagner le sujet jusqu’à une mise à jour possible, sans pulvériser son monde vécu. L’enjeu est double : (1) soigner sans humilier l’expérience ; (2) viser un accord expérientiel (progresser vers un vécu plus fiable), pas seulement un accord social (consensus externe).
IV. Vers une notion élargie : « anosognosie de réalité » ?
Pour nommer ce que l’on observe — absence de conscience du dysfonctionnement avec production d’un substitut crédible —, on peut parler de « anosognosie avec substitution (confabulée) », ou proposer l’expression « agnosie phénoménale de réparation » : non pas simple ignorance, mais réparation imaginale du monde vécu. La clinique en témoigne ; le soin consiste à restaurer la coïncidence entre ce qui se passe et ce qui se vit, sans délégitimer la parole du patient.
V. Tests cliniques rapides (utiles & non humiliants)
- Tentatives bimanuales/alternées : lever les deux bras puis un seul (vidéo discrète). Rejouer au ralenti avec le patient.
- Feedback miroir (quadri adapté) : confronter en douceur l’attente et le visible.
- Double tâche « intention → action » : « où en êtes-vous du geste ? » (verbaliser l’instant).
- Olfaction : tests neutres (flacons sans indice) puis items indicés (citron/café) pour objectiver l’écart indice→performance.
- Échelles brèves de conscience du trouble (ex. questionnaires auto/hétéro) pour suivre l’évolution.
VI. Éthique de restitution (comment « montrer » sans blesser)
- Valider le vécu : « Je comprends que vous le ressentez ainsi ».
- Proposer des signes partagés : « regardons ensemble » (image, vidéo, marqueur simple).
- Décrire, pas juger : « ici, on voit que… » plutôt que « vous avez tort ».
- Traduire en gestes utiles : sécurité, aides techniques, rééducation centrée tâche.
- Clore sur l’autonomie : « Qu’est-ce qui vous paraît juste / possible maintenant ? »
Références sélectionnées
- Babinski J. (1914) — traduction & commentaire :
Langer & Levine, Cortex, 2014. - Vocat R., Vuilleumier P. — Anosognosia for hemiplegia: a clinical–anatomical review, Brain, 2010.
- Fotopoulou A. et al. — Experimental study on AHP, Brain, 2008.
- Jenkinson P.M., Fotopoulou A. — Motor awareness in AHP, JNNP, 2010.
- Carvajal F. et al. — Anton–Babinski syndrome, 2012.
- Moein S.T. et al. — Smell dysfunction & COVID, 2020.
- Bourlon C. et al. — Objective testing & underreporting, 2021.
- Prigatano G. P. — The Study of Anosognosia, OUP, 2010.
Conclusion — La rencontre qui change les deux
Le patient n’arrive pas par hasard dans la conscience du neurologue. L’anosognosie n’est pas une « anomalie » à éliminer ni un sujet à publier pour la millième fois : c’est une invitation à déplacer sa place. Le patient, lui, tient une cohérence interne — parfois coûte que coûte. Le clinicien, lui, habite un consensus social puissant. La rencontre n’a pas pour finalité de « guérir l’anosognosie », souvent illusoire, mais d’ouvrir un espace où l’un et l’autre se transforment : le neurologue apprend à voir sans écraser le monde vécu ; le patient peut, pas à pas, ajuster son modèle de soi à des signes partagés.
La bonne question clinique devient alors : « Que me demande cette rencontre ? Qu’est-ce que ce patient change à ma façon d’habiter le réel ? » C’est à ce prix que la vérité opératoire ne se fait pas contre la vérité phénoménale — et que prend forme une médecine capable d’unir preuve et présence.
Deux échos cinématographiques
- Vanilla Sky (remake d’Abre los ojos) : croire au monde partagé ou croire à son monde propre — et choisir lucidement.
- A Beautiful Mind : « Ils sont toujours là… mais j’ai appris à reconnaître ce qui vient de moi. » Coexistence pacifiée de deux régimes du réel.
Ici aussi, le « salut » ne tient pas à l’extinction d’une partie du réel, mais à la capacité de reconnaître et d’articuler deux visions sans les mettre en guerre.
« Ouvrir les yeux, ce n’est pas imposer une vue — c’est apprendre à voir ensemble. »
Continuez l’exploration sur le thème de la Maladie
Restez sur le sujet « Dynamique thérapeutique » :
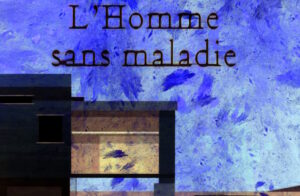
Je ne suis pas malade !
💉 La médecine préventive :Est-ce une médecine avant la maladie, donc sans maladie ? « La maladie est un modèle ; le symptôme, un moment. Le soin naît…
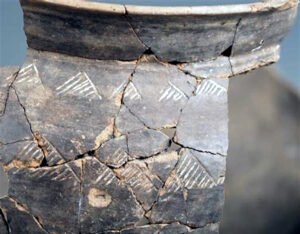
Je me traite, mais j'ai toujours aussi mal !
La vitalité de la vie côtoie la douleur dans l'espace singulier du présent. Dans ce présent, ils se livrent une guerre silencieuse, chacun rivalisant pour nous ramener au…

Je me traite, mais rien ne se passe !
Lorsqu’un traitement débute, l’amélioration est souvent subtile, un signal faible, se traduisant par un petit glissement vers un mieux-être plutôt qu’un changement radical immédiat.