Deux mouvements opposés : disséquer le vivant ou l’habiter
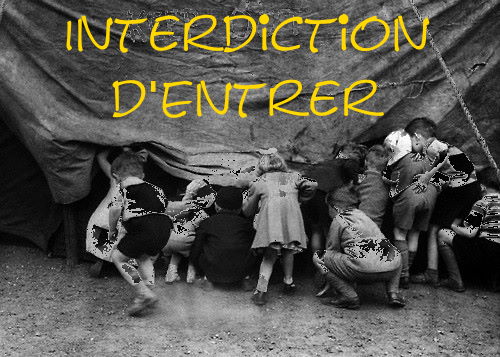
Résumé
L’histoire récente du soin raconte deux élans. Le premier, analytique, a rendu le corps lisible : l’anatomie (-tomie = couper, dissequer), la médecine de précision et les réseaux moléculaires ont détaillé l’organisme jusqu’au gène. Le second, plus discret, revient au vécu : symptôme, présence, instant. Entre ces deux gestes se joue l’avenir de la clinique. Je propose ici une intégration inversée : garder l’acquis de la précision, mais repartir de l’instant ressenti pour permettre au savoir de servir — plutôt que de filtrer — l’expérience du vivant.
Un carrefour longtemps sans nom
La médecine moderne a suivi une double pente : décomposer (pour voir juste) et recomposer (pour soigner juste). Le premier geste — analytique — a gagné : il a donné une langue commune, des techniques opératoires et des modèles puissants. Le second — habiter le corps vécu — est resté en marge. Aujourd’hui, avec l’explosion des données et des « réseaux de maladies », la question revient : comment relier ce que nous avons si bien séparé ?
Hubert von Luschka : organiser le visible pour soigner
Au XIXe siècle, Hubert von Luschka systématise l’anatomie descriptive et topographique, traçant des repères qui rendront possible une chirurgie sûre et une clinique reproductible. Il « remplit le corps d’organes » : nerfs, cloisons, orifices, conduits — une cartographie qui normalise l’espace opératoire et crée un vocabulaire partagé. C’est l’un des socles de la médecine occidentale contemporaine.
« OsC » — Organes sans corps : la segmentation sans fin
Sur cet élan, la biomédecine a poursuivi la segmentation : molécules, gènes, protéines, voies, réseaux. Network medicine modélise désormais les maladies comme des perturbations de modules interconnectés — puissant pour découvrir des cibles et comprendre les comorbidités, mais au risque d’oublier l’expérience qui ne se laisse pas quantifier.
En parallèle, la médecine de précision promet des soins calibrés sur le profil biologique de chacun ; par construction, elle reste centrée sur la « maladie » comme entité à prévenir ou à traiter — un progrès réel, mais encore « du côté des organes ».
« CsO » — Corps sans organes : de l’organe au vécu
Antonin Artaud formule le « corps sans organes » : « Quand vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l’aurez délivré de tous ses automatismes » — une image pour desserrer l’emprise des routines qui enferment le vivant. Deleuze & Guattari en feront un champ d’intensités : un corps non pas privé d’organes, mais libre des codes qui assignent et rigidifient.
Deux logiques en tension (et à articuler)
| Perspective | Point d’ancrage | Forces | Angles morts |
|---|---|---|---|
| Organes sans corps (OsC) | Entités, modules, risques, diagnostics | Précision, reproductibilité, prédiction, chirurgie/biologie puissantes | Réduction du vécu, dépendance aux marqueurs, « bruit » du symptôme |
| Corps sans organes (CsO) | Symptôme, présence, relation, rythme | Écoute, ajustement, intégration, place laissée au Kairos | Moins de protocoles, exige une haute qualité d’attention/formation |
Ma proposition : une intégration inversée
Je ne rejette rien de l’héritage analytique. Je propose d’inverser l’ordre d’entrée : 1) partir du témoignage (le symptôme comme événement), 2) ouvrir l’espace de présence, 3) formuler des hypothèses (abduction), 4) puis mobiliser les savoirs et données utiles pour vérifier/ajuster. Ce mouvement remet « le corps vécu » au centre — Merleau-Ponty parlait du corps propre, ce corps que nous sommes avant de l’avoir comme objet.
Conclusion : entre Luschka et Artaud
Luschka a rendu le corps lisible ; Artaud a rappelé que le vivant déborde nos schémas. Tenir les deux — précision et présence —, c’est ouvrir une médecine post-historique : non pas fondée sur la mémoire et les modèles, mais sur l’immédiat qui parle et que l’on vérifie. Une médecine qui dissèque quand il faut, et qui habite — toujours.
Repères cités : Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu ; Deleuze & Guattari, Mille Plateaux (corps sans organes) ; Barabási et al., « Network medicine » (Nat Rev Genet) ; National Academies & NIH (précision médecine) ; phénoménologie du corps (Merleau-Ponty).
Entre Luschka et Artaud — Note personnelle
« Je ne renie aucun savoir, mais j’inverse l’ordre d’entrée. »
D’où je viens
En fac, j’ai appris le monde par coupes et plans. Je dois à Luschka le respect du détail et la pudeur du geste juste. Au chevet pourtant, j’ai découvert qu’un corps peut être « normal » et que la détresse, elle, persiste. C’est là que l’autre héritage s’est imposé : habiter, écouter, laisser l’instant travailler.
Ce que je vois au lit du malade
« Je n’arrive plus à me tenir debout dans ma vie. » Rien, dans l’imagerie, n’explique cette phrase — et pourtant tout commence par elle. Brûlure qu’on apaise, vertige rendu au sommeil, douleur déverrouillée par un rythme retrouvé : chaque fois, je mesure que le symptôme est une porte — à condition d’oser la franchir.
Ce que retiennent mes mains
Je n’oppose pas l’organe au vécu ; j’empêche seulement l’organe de parler en premier. L’anatomie m’aide à ne pas nuire, la physiologie m’apprend la prudence, la clinique m’ordonne d’accorder d’abord la personne à ce qui la traverse : lumière, sommeil, liens, peurs, langage. Quand la présence est juste, la précision devient un allié. Dans l’autre sens, elle se fait parfois filtre.
Mon protocole le plus simple
Observer → hypothèse → vérifier. Répéter. Ajuster. Tenir le journal de ce qui étonne. Revenir au Kairos — ce moment où la vie propose une prise. Là, je convoque Luschka : « par où aborder ? » ; puis Artaud : « comment empêcher l’automatisme de refermer l’espace ? ».
Entre deux fidélités
Fidèle à Luschka quand je protège la précision et l’économie du geste. Fidèle à Artaud quand je refuse que la carte remplace le vivant. Mon travail : tenir ensemble ces deux exigences : disséquer quand il faut ; habiter, toujours.
Ce que je transmets
- Aux patients : un droit au symptôme (événement, pas erreur) et des outils : journal d’étonnement, gestes d’ancrage, réglage des rythmes.
- Aux soignants : la permission de commencer par l’instant, puis d’appeler la science — et non l’inverse.
- À ma lignée : gratitude pour la carte, et responsabilité de replacer le corps dans le champ du vivant.
Conclusion (engagement)
Si je devais résumer : « Je ne renie aucun savoir, mais j’inverse l’ordre d’entrée. » Mon avenir de clinicien se joue là : que chaque précision serve une présence, et que la présence rende chaque précision nécessaire — ou inutile.
Conclusion : une médecine post-historique :
Ce que j’appelle médecine post-historique, c’est une médecine non fondée sur le passé. Ni sur la mémoire, ni sur les organes, ni sur les modèles. C’est une médecine fondée sur l’immédiat, sur le témoignage direct du vivant, sur ce qui vibre ici et maintenant. Un retour — non vers le passé — mais vers la présence. Un soin — non contre la maladie — mais ouvert à ce qui veut naître. Peut-être est-ce cela, l’avenir du soin. Un retour sans recul, un passage hors forme, dans la lumière nue de ce qui est.
Continuez l’exploration sur le thème de la Maladie
Restez sur le sujet « Vision de la Médecine » :

Médecine Interne
En médecine interne, la science se mue en art, et chaque patient devient un compagnon de route, porteur d’un récit sincère et d’une sensibilité vibrante.

Hommage à Hubert von Luschka
Hubert von Luschka (1820–1875) – "Voir pour guérir" Cartographier le détail pour rendre la main du clinicien plus juste. Résumé Professeur à Tübingen, Hubert von Luschka incarne la…